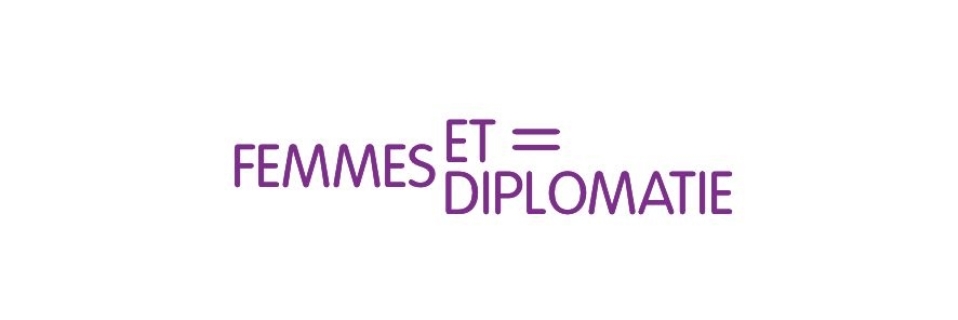
L’association Femmes&Diplomatie à organisé un séminaire en ligne pour évoquer les opportunités de carrière dans le réseau de coopération, de la culture et de la recherche. Le 15 avril dernier, l’événement à réuni Marie Buscail, COCAC au Liban, Cécile Frobert, COCAC en Tanzanie, Minh-Ha Pham, Conseillère pour la science et la technologie à Londres, et Jean-François Pactet, directeur adjoint de DCERR. Hélène Roos, vice-présidente de F&D, et elle-même COCAC en Roumanie, en a modéré les débats.
Engagée pour accompagner les femmes du MESRI dans l’accession de postes à responsabilité, l’AFDESRI a eu le plaisir d’être invitée à participer au débat et y a été représentée par Minh-Hà Pham, membre du conseil d’administration. Voici les éléments clés à retenir des interventions et des échanges du webinaire :
4500 agents dont une majorité d’ADL et 1700 expatriés évoluent dans le réseau culturel. Ce réseau offre 113 postes universitaires et scientifiques, occupés à 36% des femmes.
Les candidates doivent prendre en compte trois enjeux pour entrer dans ce réseau :
- la dimension technique sur un champ large (culture, éducation, coopération, recherche) requiert un investissement initial significatif.
- l’encadrement, la gestion d’équipe et plus généralement les relations humaines occupent une part conséquente de l’activité. Un intérêt prononcé pour ces fonctions est donc nécessaire.
- Un poste dans le réseau doit s’inscrire dans un parcours de carrière pour développer sur le long terme les expertises et compétences qu’on y acquiert pour construire un parcours dédié à l’influence. Un poste dans le réseau se conçoit autant en début qu’en milieu de carrière.
Pour Marie Buscail qui a été VIA au SCAC au Yémen, dans la filière politique et actuellement COCAC au Liban, la gestion d’un des plus importants réseaux nationaux d’Institut français s’apparente à la gestion d’une PME. Le métier combine donc cette dimension entrepreneuriale avec une forte dimension de stratégie, les IF étant des établissements autonomes financièrement mobilisant 70% de ressources propres, et le conseil politique de l’ambassadeur sur les questions culturelles et de coopération. Viennent s’y ajouter également les relations publiques, particulièrement importantes dans un pays comme le Liban
Cécile Frobert fait face aux mêmes enjeux en Tanzanie, gérant un important réseau d’alliances françaises (de droit local). Son poste se partage entre contacts politiques de haut niveau (présidence, ministères) et gestion d’une équipe aux profils, parcours et statuts divers. Au niveau politique, elle définit la stratégie de coopération de l’ambassade et gère les interactions avec les autres bailleurs et au niveau interne. Au sein du réseau, la gestion des établissements scolaires l’amènent à aborder tant des questions immobilières que bancaires. Evoluer dans des postes en Afrique requiert d’avoir une appétence confirmée pour les relations humaines.
Minh-Hà Pham qui a occupé plusieurs postes de direction au CNRS ainsi que les postes d’attaché scientifique à Washington et actuellement à Londres, souligne que les représentantes du MESRI en entrant dans le réseau doivent accepter d’élargir leur expertise technique et se familiariser avec la culture diplomatique comme accepter de nouvelles règles hiérarchiques. Une certaine pédagogie pour accompagner les mobilités est donc nécessaire pour que les partantes puissent se préparer et se familiariser à leur nouvel environnement professionnel.
La conciliation entre vie familiale et vie professionnelle s’organise dans le contexte de la répartition des tâches entre l’ensemble des agents du SCAC, les postes sont donc accessibles à celles qui souhaitent préserver leur vie de famille.
Les questions de gestion administrative et financière ne nécessitent pas une spécialisation spécifique au préalable, les COCAC pouvant s’appuyer sur des secrétaires généraux et des agents comptables de qualité. Par ailleurs, la sous-direction du réseau a pour mission d’appuyer les SCAC/IF dans la mise en œuvre de leurs missions. En revanche, se familiariser au langage des opérateurs comme à celui des universitaires et scientifiques peut faciliter la prise de poste. Il est par ailleurs de la responsabilité des COCAC de faire œuvre de pédagogie pour expliquer aux personnels extérieurs au ministère au sein de leurs équipes le fonctionnement et la culture de ce dernier. Enfin, les réunions régionales du réseau, les journées des opérateurs (IF et Campus France) et du réseau facilitent les partages d’expérience et de bonnes pratiques.
Envisager tôt un passage par le réseau culturel ne constitue pas un risque d’enfermement dans une filière, les carrières au ministère nécessitant d’évoluer d’un domaine d’expertise à un autre. En revanche, l’expérience de la filière politique est un avantage dans les grands SCAC/IF.
Nous espérons que ces témoignages enthousiastes et les échanges riches qu’ils ont suscités auront suscité des vocations dans la filière culturelle.
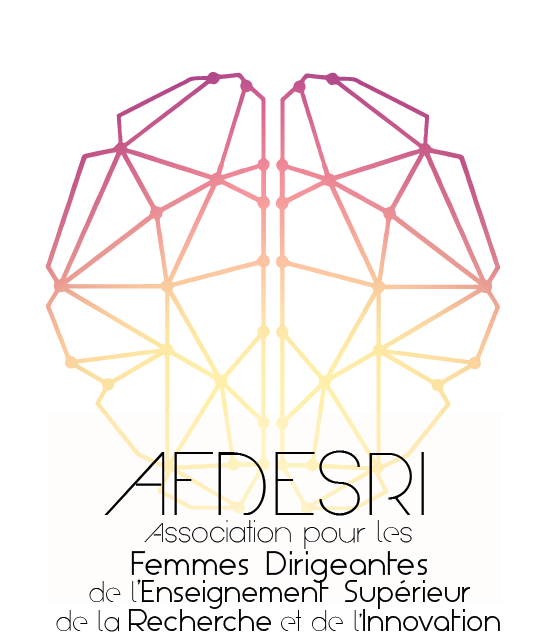


Commentaires récents