
La Conférence des grandes écoles (CGE) a publié en mai 2025 son baromètre annuel « Égalité femmes-hommes ». Ce rapport, devenu un outil de référence, dresse un état des lieux précis de la place des femmes dans les grandes écoles et met en lumière des inégalités persistantes, y compris au sommet des organigrammes.
Un constat préoccupant
Le baromètre révèle plusieurs tendances fortes :
- Des formations initiales non mixtes : les écoles d’ingénieurs, en particulier, restent marquées par une prédominance masculine.
- Des écoles de management pas totalement mixtes : bien qu’elles soient perçues comme plus ouvertes, les écoles de management affichent elles aussi des déséquilibres notables, tant au niveau des étudiants que des instances dirigeantes.
- Une gouvernance déséquilibrée : les femmes sont largement minoritaires dans l’ensemble des instances de direction, y compris au sein des grandes écoles. Cette sous-représentation est encore plus marquée dans les postes stratégiques (direction générale, présidence, conseils).
Pourquoi ce baromètre est important
Le baromètre CGE ne se contente pas de dresser des chiffres : il analyse les causes profondes de ces déséquilibres et les freins identifiés par les établissements. Il constitue un outil de diagnostic essentiel pour les écoles qui souhaitent s’engager concrètement vers plus d’égalité.
Points notables :
- Le manque de modèles féminins dans les filières scientifiques et technologiques.
- La persistance des stéréotypes de genre dans l’orientation des élèves.
- Les freins institutionnels qui ralentissent l’accès des femmes aux plus hauts niveaux de gouvernance.
- L’absence de mécanismes contraignants dans certains établissements pour garantir une parité réelle.
Des efforts sur les violences sexistes et sexuelles
Le rapport consacre également un focus à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS). Il évalue le degré de mise en œuvre des dispositifs obligatoires dans les établissements :
- existence d’un référent VSS,
- dispositifs d’écoute et de signalement,
- campagnes de prévention,
- prise en charge des victimes.
Il rappelle que les écoles doivent aller au-delà de la simple conformité réglementaire et inscrire cette lutte au cœur de leur culture institutionnelle.
Quelles perspectives pour les écoles ?
Les constats du baromètre appellent à des actions ambitieuses :
- Mettre en place des indicateurs de suivi : suivre les nominations, les promotions, les écarts de rémunération.
- Former les comités de recrutement et de sélection à la question de la parité.
- Favoriser l’émergence de rôles modèles féminins, notamment en sciences, pour inspirer les étudiantes.
- Créer des conditions d’accès équitables aux postes de gouvernance, avec des mesures correctrices si nécessaire.
- Renforcer les partenariats entre établissements pour partager les bonnes pratiques et s’inspirer mutuellement.
Pourquoi faut-il en parler ?
La gouvernance des établissements d’enseignement supérieur façonne les orientations stratégiques, les choix budgétaires, les politiques de recrutement et d’innovation. Sans présence équilibrée des femmes, ces décisions risquent de reproduire des biais et de freiner l’évolution vers une société plus juste, plus inclusive et plus innovante.
En relayant ces résultats, nous souhaitons contribuer à une prise de conscience collective et encourager chaque acteur à prendre sa part de responsabilité.
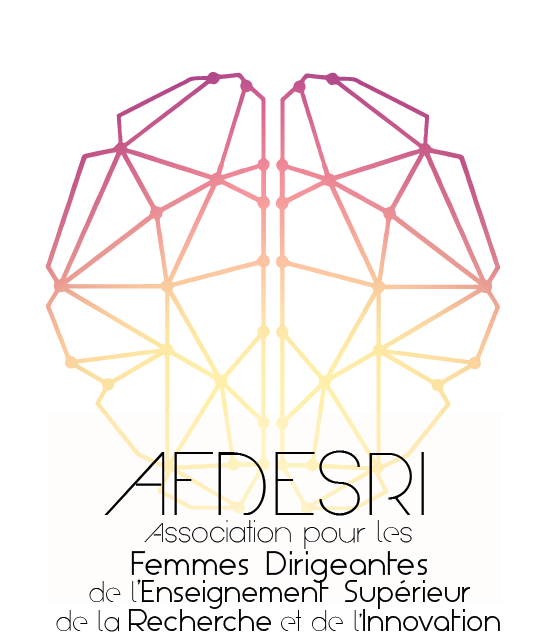




Commentaires récents